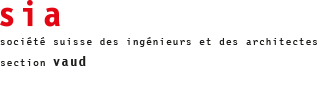Urbanités du 15 septembre 2025 - Le compte rendu
Verena Pierret, membre du Groupe Environnement et Durabilité (GED) de la SIA Vaud et modératrice de la soirée, souhaite la bienvenue au public nombreux venu pour ce débat consacré à l’intelligence artificielle (IA) et à la durabilité dans le milieu bâti. Elle relève la complexité du sujet et la volonté du GED d’aborder le sujet de l’IA dans une perspective durable et en lien avec les métiers de la construction.
Elle demande ensuite à l’assemblée qui a déjà utilisé l’IA. Pratiquement tout le monde lève la main. Elle poursuit en demandant qui peut en expliquer le fonctionnement. Peu de mains se lèvent. Elle passe donc la parole au premier intervenant en soulignant la nécessité de prendre ce sujet à bras le corps pour mieux en saisir les enjeux.
Intelligence artificielle et durabilité dans le milieu bâti
Sascha Nick, chercheur EPFL, Scientifique, Laboratoire d’économie environnementale et urbaine
Sasha Nick débute son intervention en annonçant qu’il s’apprête à partager davantage de questions que de réponses. Pour lui, la plus importante d’entre elles est simple : dans quel genre de société voulons-nous vivre ? Pour répondre à cette question, le milieu bâti sera un aspect essentiel car il a des impacts à plusieurs échelles et agit directement sur notre bien-être.
Il poursuit en évoquant l’agriculture, la technologie la plus importante de l’histoire de l’humanité. Aujourd’hui, avec 10’000 ans de recul, il reste difficile d’affirmer que l’évolution de l’agriculture est une avancée pour l’avenir de l’humanité. En effet, si avec la révolution verte les rendements ont été décuplés, on produit aujourd’hui de la nourriture pour 35 milliards de personnes dont une immense quantité est gaspillée, et six des neuf limites planétaires ont été dépassées.
Sasha Nick présente ensuite un autre exemple, celui d’une machine développée aux États-Unis et permettant d’automatiser la récolte des tomates. Sa mise sur le marché est intervenue car les ouvriers mexicains ne pouvaient plus être engagés pour cette tâche, et les ouvriers américains étaient trop chers. Cette machine a bouleversé l’agriculture en Californie : de grandes firmes ont monopolisé le marché, l’emploi a été réduit dans le secteur fermier, et la variété des tomates a été réduite à une seule sorte. Mais dans le même temps, le mécontentement de la population face à cette situation a donné naissance au mouvement favorisant l’agriculture bio et locale aux États-Unis.
⇒ Ces deux exemples montrent qu’il est toujours compliqué de connaître l’impact global d’une technologie.
Sasha Nick évoque ensuite l’approche utilisée dans ses travaux de recherche, une approche basée sur des systèmes et avec des leviers permettant d’agir sur ces systèmes. Cette approche peut être appliquée au domaine du bâtiment en Suisse. Actuellement, le milieu bâti helvétique est peu durable ; Sasha Nick énonce quelques chiffres évocateurs : 17 millions de pièces individuelles sont vides en permanence, et seul 1% du parc bâti est en classe énergétique A. Pour remédier à ces enjeux, une des mesures consisterait à réduire la partie privée allouée à chacun·e.
Il présente ensuite l’exemple de deux communes à Genève dont la transformation a permis un meilleur taux d’accessibilité vers dix services essentiels. La commune devient plus compacte et s’organise autour de plusieurs centres. Les liens sociaux bénéficient également de ces transformations.
Sasha Nick conclut en évoquant la BD Utop’IA, qui définit deux avenirs possibles liés à l’utilisation de l’IA. Vers quel modèle voulons-nous aller ? Ce qui importe, ce n’est pas la technologie, mais le système socio-économique dans lequel elle s’insère. Et selon lui, l’IA doit soutenir un processus de délibération citoyenne, un élément nécessaire pour tendre vers un avenir durable.
IA et durabilité dans le milieu bâti
Sabine Jacot, formatrice IA Senior, OUTILIA Sàrl
Sabine Jacot représente Outilia, une société qui a formé plus de 150 entreprises et institutions en Suisse romande.
Elle commence par mettre en garde le public sur une des premières grandes limites rencontrées lors de l’utilisation d’une IA générative conversationnelle (telle que ChatGPT) : il s’agit des hallucinations. En effet, si l’on pose une question factuelle comme on le ferait sur un moteur de recherche (par exemple le résultat d’un match de football), il y a une chance sur deux que la réponse soit fausse.
En effet, Sabine Jacot souligne que ChatGPT est un peu comme un·e stagiaire omniscient·e, mais qui désire plaire à tout prix, quitte à donner une mauvaise réponse. Pour cela, l’humain est indispensable afin de superviser l’IA. Afin de limiter ces hallucinations, l’une des stratégies consiste à insérer un PDF comme base afin de canaliser la recherche.
Sabine Jacot rappelle que le fonctionnement d’une IA générative n’intègre pas de cognition ; elle prédit sur des enchaînements de mots le prochain mot le plus probable. On peut ainsi faire générer à ChatGPT un paragraphe structuré et argumenté sur la raison pour laquelle les martiens aiment les bananes.
-
Résumer un document
-
Chercher des informations précises dans une grande quantité de documentation
-
Rédiger des textes
-
Vulgariser les informations techniques pour les client·es
Enfin, Sabine Jacot aborde la question de la protection des données. Malgré la démocratisation massive de l’IA, trois quarts des entreprises en Suisse ne possèdent pas de charte IA. L’utilisation de l’IA doit être adaptée au niveau de confidentialité des données, qu’il est parfois nécessaire d’anonymiser.
« De la donnée brute à la décision éclairée » - IA & performance énergétique
Maël Perret, CEO et co-fondateur de Dyneo Technologies SA, formateur HES-SO
Maël Perret débute son intervention en soulignant que les médias parlent beaucoup de l’IA comme d’une révolution. Pourtant, le terme de date pas d’hier, puisque déjà en 1940, il désignait une technique permettant à un ordinateur de copier le comportement d’un être humain. Dès les années 80, on développe le machine learning, qui consiste à alimenter des ordinateurs en données pour leur « apprendre à apprendre » et leur permettre ainsi de réaliser des tâches précises et spécifiques. Depuis les années 2010, on parle de deep learning, un procédé basé sur des réseaux neuronaux et visant à copier le fonctionnement du cerveau humain.
Depuis les années 40, la consommation énergétique finale a été multipliée par 8, en partie en raison de cette (r)évolution numérique. En 2022, les centres de données du monde entier ont consommé autant d’électricité que la France entière.
En parallèle, il est intéressant de constater qu’avant 2020, la majeure partie de la consommation énergétique liée à l’utilisation de l’IA était imputée à la partie « entraînement ». Aujourd’hui, on crée des puces qui consomment moins d’énergie, permettant ainsi de réduire la consommation dédiée à l’entraînement de l’IA. Toutefois, avec l’utilisation massive de l’IA par des millions de personne, la consommation continue d’augmenter, mais la majeure partie de l’énergie utilisée est désormais imputable à la phase d’utilisation.
Mäel Perret présente ensuite le travail de son entreprise, Dyneo, qui vise à décarboner les sources d’énergie des réseaux de chaleurs et à réduire leur consommation en utilisant la technologie et l’IA.
Pour illustrer son propos, il prend l’exemple du réseau de Grenoble. À raison de cinq données par bâtiment, relevées toutes les cinq minutes, cela représente un demi-milliard de données par année. Résultat : les exploitant·es sont bombardé·es de données et passent l’essentiel de leur temps (80%) à les traiter. La question se pose : a-t-on besoin d’autant de données, sachant que 60% d’entre elles ne seront plus jamais utilisées ? ⇒ Avec l’utilisation de l’IA, Maël Perret montre que le temps de traitement des données peut être réduit à 10%, permettant ainsi aux exploitant·es de libérer du temps pour œuvrer à augmenter l’efficacité du réseau.
À terme, il est intéressant de constater que les économies d’énergie réalisées surpassent largement la quantité d’énergie utilisée par l’IA.
Maël Perret conclut en rappelant que lorsque l’on souhaite utiliser l’IA, il est essentiel de réfléchir à l’usage, de s’entourer de professionnel·les et de former les utilisateur·rices. L’IA ne remplace pas les humains, elle transforme des métiers.
Pourquoi l’IA chez Salza
Olivier de Perrot, architecte ETH SIA, CEO Salza
Olivier de Perrot commence par présenter son entreprise. Salza est une plateforme de réemploi des éléments de construction qui est partie d’un constat : avec plus de 5000 déconstructions par année, de nombreux éléments sont jetés, alors qu’ils pourraient être utilisés ailleurs. Salza se donne donc pour mission de faire le lien entre les personnes qui démolissent et celles qui pourraient avoir besoin des éléments, en les mettant à disposition sur la plateforme avant le début des chantiers.
Salza ne fonctionne pas comme une ressourcerie ; les bâtiments en voie d’être démolis font office de lieu de stockage intermédiaire. Cette façon de procéder permet de mettre un large choix d’éléments à disposition, y compris de gros éléments (comme des ponts) qui ne pourraient jamais être déposés en ressourcerie.
Pour optimiser son fonctionnement, la plateforme utilise l’IA au moment d’ajouter un élément sur la plateforme ; de nombreuses informations y sont insérées automatiquement, facilitant ainsi le travail des personnes qui proposent des éléments à réemployer. Pour la suite, Olivier de Perrot espère que l’IA pourra être utile pour faciliter le travail d’inventaire.
Table ronde
La table ronde est animée, et de nombreux sujets sont abordés.
La question de la sobriété est soulevée par une personne du public. A cet égard, Sasha Nick recommande de ne pas se focaliser sur les détails, mais de questionner les usages et de se demander de quel type de société nous voulons.
Les intervenant·es abordent également la question de la formation à l’IA. Sabine Jacot insiste sur la nécessité d’en faire un usage citoyen, responsable et éclairé. L’IA étant désormais entre les mains de millions de personnes, y compris les jeunes générations, il est essentiel de maintenir un esprit critique pour en comprendre le fonctionnement, les enjeux et le potentiel.
La question des biais de l’IA est ensuite soulevée. En effet, les IA sont actuellement entraînées sur des données produites par des humains, et donc avec tous les biais qui leurs sont propres.
Le sujet de l’effet tunnel est également abordé. En effet, si l’IA utilise tout le temps les mêmes données, elle finira par fournir toujours les mêmes réponses, et il existe un vrai risque de perdre en créativité. Sasha Nick insiste sur le fait que l’imagination ne peut venir que des humains, car les IA en sont par nature dépourvues.