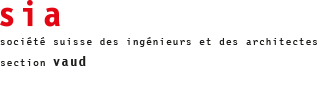Urbanités du 22 avril 2024 - Le compte rendu
Stéphane Commend, modérateur et organisateur de la soirée, remercie le public pour sa présence.
Il introduit la rencontre avec un constat : on entend beaucoup de choses au sujet de la qualité des prestations des mandataires, prétendument en baisse. Pourtant, il existe des outils permettant de concevoir de manière correcte et d’optimiser. Où se situe donc le problème ? S’agit-il d’enjeux de budget, de manque de temps, d’incompétence, voire de flemme ? Il relate également une impression générale au sein de la profession, qui a le sentiment de passer beaucoup de temps à remplir des tableaux Excel plutôt qu’à réaliser des calculs, une compétence pourtant au cœur de la formation d’ingénieur·e.
Afin d’optimiser les projets, Stéphane Commend rappelle l’importance de deux ingrédients : une base de décision composée de normes, de bon sens et d’acceptabilité d’un certain risque, et l’implication de tous les partenaires du projet.
Il détaille ensuite l’approche proposée, qui permet de définir des valeurs seuils puis de faire des prédictions sur la base d’un modèle. Il est normal que des incertitudes subsistent. Stéphane Commend préconise une approche probabiliste. Le chantier est ensuite instrumenté, puis les prédictions pourront être mises à jour afin de prendre une décision.
Pour illustrer son propos, il présente l’exemple d’un projet pour le siège d’une banque dans la région genevoise. Au lieu d’utiliser l’approche déterministe, c’est une approche basée sur les probabilités qui a été choisie. Les prédictions sont mises à jour au fur et à mesure de la construction, ce qui permet une solide base de décision.
Céline Weber
Ingénieure, fondatrice de Focus-E, conseillère nationale PVL
Céline Weber possède plusieurs casquettes. Outre son métier d’ingénieure et sa fonction politique, elle est également présidente de la commission des normes à la SIA centrale.
Elle débute son intervention en rappelant les coûts de la bureaucratie en Suisse, évalués par le SECO à 6,3 milliards de francs par an, ce qui représente 100 francs par mois et par personne active.
La charge administrative est lourde pour les entreprises, notamment en raison de notre situation avec l’Union Européenne qui nécessite des démarches importantes pour faire reconnaître et exporter des produits. Le secteur de la construction est particulièrement concerné par ces enjeux.
Céline Weber explique par exemple que lorsque l’on remplit un appel d’offres, il est nécessaire de remplir un long questionnaire sur la formation des apprenti·es, alors même que l’appel d’offres exige des prestations de niveau HES ou EPF, et que donc il s’agit d’un domaine ne formant pas d’apprenti·es.
Sur la base de ce constat de déconnexion entre lois et pratique, elle exhorte les ingénieur·es et architectes dans la salle à se lancer en politique, afin que les lois ne soient plus élaborées uniquement par des juristes, mais aussi et surtout par des spécialistes du domaine concerné.
Elle termine en évoquant un autre problème auquel elle est confrontée en tant que politicienne : le fait que les normes sont souvent intégrées sans adaptation dans les lois par les parlementaires. Or, les normes doivent être considérées comme des aides à l’élaboration des lois, par comme des lois en tant que telles.
Didier Bourqui
Ingénieur, responsable structure et géotechnique chez Losinger-Marazzi, président du GI SIA Vaud
Didier Bourqui démarre avec quelques exemples d’optimisations réalisées au cours des dernières années par Losinger Marazzi. Il présente plusieurs cas d’étude.
Une fois les projets à leur terme, on réalise que grâceau calcul, il devient possible d’économiser des coûts importants, par exemple en optimisant les travaux spéciaux.
Il souligne que le fait d’optimiser les structures représente à la fois un enjeu concurrentiel et un enjeu de durabilité. Grâce à ce type de démarche, il devient possible d’accélérer le planning de réalisation et de fiabiliser le concept.
Il conclut en rappelant l’importance de se poser les bonnes questions sur la façon de définir ses prestations, tout comme la nécessité de s’entourer des bons partenaires.
Nicolas Fröhlich
Architecte, représentant du maître de l’ouvrage (MO)
-
Optimiser sous-entend que les spécialistes travaillent à améliorer le projet, mais le MO peut parfois s’interroger sur la raison pour laquelle cette optimisation n’est pas réalisée d’entrée de jeu.
-
Pour un MO, le terme structure implique surtout de savoir comment les responsabilités seront distribuées au sein des mandataires.
-
L’aspect conception concerne surtout l’architecture, car les concepts structurels demeurent plus flous aux yeux d’un MO non spécialiste. Au moment de construire un bâtiment, le client s’attache avant tout à son futur aspect esthétique.
-
Enfin, pour le MO, faire référence au calcul implique avant tout le contrôle des coûts. Il compte sur les mandataires pour optimiser et faire des économies en cas de dépassements des coûts estimés.
Nicolas Fröhlich termine son intervention en évoquant le béton et sa mauvaise réputation pour des questions de durabilité. Il estime qu’arrêter le béton ne résoudra pas tous les problèmes, et que ce matériau reste nécessaire dans certains projets.
Aurelio Muttoni - Pour une utilisation plus responsable des matériaux de construction
Ingénieur, professeur honoraire de l’EPFL, fondateur de Muttoni Partners Ingénieurs Conseils
Aurelio Muttoni commence par présenter un graphique de la consommation d’énergie en Suisse entre 1910 et 2022, graphique où l’on constate une consommation stable jusqu’à la deuxième guerre mondiale, puis une augmentation exponentielle jusqu’en 1973. Depuis lors, la courbe tend à s’aplanir. On constate la même évolution avec les matériaux de construction.
Aurelio Muttoni affiche ensuite un graphique mettant en lien l’évolution des émissions de CO2 et celle de la consommation de ciment, une corrélation évidente. S’il se dit préoccupé en tant que citoyen, son côté ingénieur est satisfait car cette situation obligera les spécialistes à devenir plus raisonnables dans leur utilisation de ce matériau.
Il ne juge pas saine la discussion concernant le choix d’un matériau plutôt qu’un autre. Le matériau idéal diffère en effet pour chaque projet. Il nuance également les préjugés sur le béton, qui selon lui peut être utilisé de façon très efficace et durable. Lorsque l’on optimise l’utilisation d’un matériau, on réduit les coûts et l’impact écologique.
Aurelio Muttoni présente ensuite l’exemple d’un projet de galerie de protection contre les avalanches, un projet dans lequel les quantités de béton ont pu être fortement réduites grâce à une optimisation de la structure et à l’utilisation pour le mur de soutènement de blocs de pierre trouvés sur place.
Il conclut en mettant en évidence le fort potentiel d’optimisation des structures et de réduction du contenu de ciment par m3 de béton. En prenant les mesures adéquates, les économies peuvent être considérables, tant en termes d’émissions de CO2 que de coûts.
Alain Oulevey
Ingénieur, co-président SIA suisse, directeur chez De Cérenville Géotechnique
Alain Oulevey indique qu’il va aborder l’optimisation dans le domaine de la géotechnique à travers un exemple de projet situé à Crissier dans le quartier Oassis. Le projet contient deux programmes : des unités d’habitation et un pavillon qui abrite aujourd’hui un centre de jeunesse, une bibliothèque et une salle polyvalente. C’est sur ce second bâtiment que porte la présentation d’Alain Oulevey.
Le projet possède une géométrie compliquée et plusieurs contraintes non négligeables : la présence de deux chantiers en simultané, la proximité des enceintes et la présence d’ancrages en fonction.
En géotechnique, la première optimisation, c’est la connaissance. Dès le début du projet, il faut réaliser des sondages pour disposer d’informations. Dans le cas du projet présenté, la solution classique a rapidement été abandonnée. Une fouille circulaire a d’abord été envisagée, mais c’est finalement l’option d’un anneau extérieur qui a été privilégiée. D’autres calculs ainsi qu’un modèle numérique ont ensuite été réalisés pour obtenir des résultats plus précis concernant la déformation, les tassements et les efforts, et pour dimensionner les structures.
La phase de chantier a ensuite pu se dérouler normalement. A son terme, tout est retiré, il ne reste que le bâtiment (et les micro-pieux de la grue).
Alain Oulevey conclut en soulignant l’importance de bien réfléchir ; cela permet de gagner de l’argent et du temps, de préserver les ressources, de gagner en qualité, d’innover et de prendre du plaisir dans son métier. Il termine en rappelant que pour bien réfléchir, il faut une bonne formation, des honoraires, et de la confiance, car le métier des mandataires ingénieur·es repose avant tout sur la confiance.
Echange d’idées
La discussion avec le public est riche, voici quelques-uns des éléments soulevés.
La discussion du soir montre l’importance de se battre pour des honoraires permettant aux ingénieur·es d’avoir le temps de réfléchir. Ces professions, leur complexité et la matière grise qu’elles apportent doivent être valorisées, et les maîtres d’ouvrage doivent en prendre conscience. La SIA doit également jouer un rôle pour protéger les salaires de ses membres.
-
Alain Oulevey souligne l’intérêt de ce type de solution et le rôle de la SIA qui se doit de réfléchir au concours et à la façon de peut-être l’adapter aux mandataires techniques.
-
Stéphane Commend relève d’ailleurs que c’est souvent lorsqu’il a travaillé avec une entreprise participant à un concours qu’il a trouvé des idées particulièrement inventives.
-
Francine Wegmüller (dans le public) nuance toutefois en rappelant qu’un·e ingénieur·e gère souvent entre 10 et 15 projets en parallèle, et qu’il ne serait donc pas possible d’investir du temps supplémentaire pour participer à des concours.
Certaines personnes dans le public déplorent également le fossé existant entre les études et la réalité du métier. Beaucoup de mail et de la gestion financière, un quotidien qui ne laisse que peu de place pour faire de l’ingénierie civile.