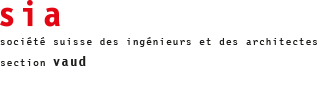Urbanités du 10 février 2025 - Le compte rendu
Verena Pierret, membre du Groupe Environnnement et Durabilité (GED) de la SIA Vaud, souhaite la bienvenue aux nombreuses personnes présentes dans la salle. Elle présente rapidement le GED et quelques unes de ses activités.
Elle introduit le thème de la soirée avec une anecdote vécue lors de la Journée Oser tous les métiers. Alors que Verena Pierret évoquait une maison construite en terre, une élève s’est étonnée d’une telle pratique, trouvant cela sale. Cette anecdote témoigne bien des préjugés existant encore sur la terre et sur la nature en ville de manière générale.
Verena Pierret passe ensuite la parole au premier intervenant de la soirée.
Le patrimoine arboré dans les projets de construction
Nicolas Nançoz, Chef de projet nature en ville – DGE-Biodiv, État de Vaud
Nicolas Nançoz aborde dans son travail le thème de la nature dans l’espace bâti, mais il se dédie tout particulièrement à la protection du patrimoine arboré.
Il introduit son propos en rappelant la situation alarmante de la biodiversité en Suisse. À côté de ses voisins, notre pays ne fait pas figure de bon élève en ce qui concerne les espèces menacées. Dans ce contexte, le patrimoine arboré est un précieux allié. Plus largement, il apporte de nombreux services et bénéfices environnementaux, climatiques et sociétaux. Il est donc particulièrement important d’en prendre soin au sein du milieu bâti.
C’est en partant de ce constat que la nouvelle loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP) est récemment entrée en vigueur. Dans ce texte, toute une série d’articles portent sur le patrimoine arboré et renforcent sa protection. Des mesures qui font parfois débat, notamment concernant leur mise en application.
La loi distingue les éléments protégés de ceux qui ne le sont pas, et ce pour différentes zones. Elle prévoit trois motifs de dérogation à la protection du patrimoine arboré et autorise donc dans ces cas l’abattage d’un arbre : en cas de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés, d’entrave avérée à l’exploitation agricole ou d’impératifs de construction ou d’aménagement. Ce dernier point étant difficile à définir, un article le détaille plus précisément. Et la nouvelle loi introduit un changement de paradigme, puisqu’à présent, il devient nécessaire de démontrer qu’il n’est pas possible de construire ailleurs ou différemment sans procéder à un abattage d’arbre. C’est au constructeur ou au promoteur qu’incombe la responsabilité de le prouver.
Si la preuve est apportée et que l’abattage d’un arbre se justifie, la loi prévoit une plantation compensatoire avec différentes conditions, et des mesures alternatives ou des taxes compensatoires qui s’appliquent si la plantation d’un arbre n’est pas possible.
Nicolas Nançoz présente ensuite quelques normes utiles traitant du patrimoine arboré et de sa protection.
Malgré l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi, elle reste très générale et ne répond de loin pas à toutes les interrogations. Un règlement d’application l’accompagne pour en préciser certains éléments. Mais dans les premières années de vie d’une loi, c’est la jurisprudence qui revêt une importance particulière. Nicolas Nançoz présente l’exemple d’un arrêt concernant un projet de construction à Prilly qui prévoyait une surélévation, un nouveau bâtiment et un parking. Le projet nécessitait l’abattage d’un cordon boisé de 29 arbres situé en bordure de parcelle. Malgré l’autorisation délivrée par la commune, les propriétaires de la parcelle voisine ont déposé un recours et ont obtenu gain de cause auprès du Tribunal Cantonal, qui a estimé que la perte de 460 m2 (et de 4 appartements sur les 47 prévus) permettrait de préserver le cordon boisé.
Nicolas Nançoz conclut son intervention en évoquant le sujet des arbres remarquables, dont l’inventaire sur le territoire vaudois est en cours par les communes. Le Conseil d’Etat trie les propositions reçues des communes selon plusieurs critères et inscrit certains arbres à l’inventaire. Dès lors, toute intervention sur ces arbres, y compris leur système racinaire, doit faire l’objet d’une autorisation spéciale du Canton.
Hospitalité écologique
Nathalie Mongé, Architecte paysagiste dplg-fsap et urbaniste, enseignante hepia, atelier apaar, Genève
En tant que praticienne de l’architecture du paysage, Nathalie Mongé abordera la façon d’accueillir la biodiversité dans les projets urbains et les réflexions qui traversent les professionnel·les en lien avec ces projets.
Elle débute avec une citation qui décrit et questionne notre paysage environnant et l’accueil de la biodiversité en ville. Comment aller de l’avant pour être meilleur·es ?
Les pratiques commencent toutefois à évoluer, en témoigne un schéma illustrant le passage d’une nature fortement artificialisée à une nature sauvage à forte valeur écologique. La végétation en ville commence à être perçue différemment, et réintroduite dans un cadre plus naturel et spontané. Nous restons néanmoins fortement influencé·es par notre volonté de maîtrise et par un standard esthétique. Comment dès lors construire une ville qui ne serait pas uniquement réservée aux humains et qui pourraient accueillir davantage de milieux de biodiversité ?
Nathalie Mongé mobilise pour cela le concept d’anfractuosité, qui renvoie à l’idée de créer des conduits, des failles et des refuges permettant au vivant de s’installer. À l’image de ce que l’on trouve dans le sol, ces failles créent des flux d’air, d’eau, d’organismes, etc. On peut également en retrouver au-dessus de la surface du sol, avec par exemple des amas de branches ou de feuilles.
Nathalie Mongé souligne l’importance des creux comme éléments d’aménagement : ils accueillent la vie, captent l’eau de pluie et contribuent à créer de nouvelles formes de paysage. Tant dans l’aménagement paysager qu’à l’échelle de la ville, ces anfractuosités revêtent une grande importance.
En lien avec cette notion de creux, elle déplore le fait que l’on ne s’intéresse que trop peu à l’invisible, ce qui se trouve sous le sol. Or, le soin apporté au sous-sol est crucial pour un paysage plus vivant. Nathalie Mongé présente un projet à Bienne dans lequel le sous-sol a été particulièrement soigné, avec notamment un plan « sous-sol » pour le concours. Elle souligne l’importance de garder une continuité dans le sous-sol.
Elle poursuit avec le sujet de la désartificialisation des sols, un acte important et bénéfique dans nos villes majoritairement imperméabilisées. Nathalie Mongé évoque un projet de désartificialisation du sol à Genève. Le béton y a été scié, et les dalles stockées et réutilisées pour en faire des murets intégrant des nichoirs à oiseaux.
Enfin, elle pose la question de la façon de mobiliser autour des sols, aujourd’hui trop peu protégés par des lois. En France il existe le ZAN (zéro artificialisation net) et en Belgique la stratégie « Good soil », des outils permettant d’aller de l’avant et de proposer des modèles d’urbanisation différents.
Nathalie Mongé conclut en relevant qu’au lieu d’adapter les mesures climatiques aux normes esthétiques existantes, il serait peut-être plus judicieux de faire évoluer notre conception du beau et notre façon de créer la ville.
Murs biodiverses - Architecture support de biodiversité
Delphine Lewandowski, Architecte diplômée d’État-HMONP, docteure en architecture et enseignante
Delphine Lewandowski intervient en tant que chercheuse en architecture pour présenter son travail de recherche portant sur un dispositif d’accueil de la biodiversité dans les bâtiments.
Elle commence par rappeler que la crise environnementale est une crise du design, et que c’est dans ce contexte que s’inscrit la volonté d’accueillir le vivant en ville. Elle rappelle également qu’à l’heure actuelle, 56% de la population mondiale vit en ville, ces mêmes villes qui feront partie des premières victimes des changements climatiques. Y intégrer davantage de nature revêt donc une importance toute particulière pour la résilience des villes.
Elle poursuit en évoquant le contexte actuel d’érosion globale de la biodiversité, une érosion sans précédent qu’une étude a chiffrée en estimant à un million le nombre d’espèces actuellement menacées d’extinction en raison de l’activité humaine. L’urbanisation représente l’un des facteurs majeurs d’érosion de la biodiversité.
Dans ce contexte, Delphine Lewandowski relève que l’architecture peut être conçue pour accueillir le vivant. Elle évoque l’exemple d’une expérience pionnière à Boulogne-Billancourt avec un toit végétalisé conçu comme un milieu naturel typique de la région, avec dans les murs des interstices permettant à la biodiversité de se développer. C’est ce projet qui a lui a donné l’idée de sa recherche, dont elle présente les grandes questions, et qui s’inscrit dans une approche transversale et multidisciplinaire.
Elle poursuit avec quelques éléments théoriques sur les murs végétalisés. La recherche à ce sujet est récente ; elle classe les murs en deux catégories : façades vertes et murs vivants. C’est dans cette deuxième catégorie que s’inscrit sa recherche. En parallèle se développent d’autres typologies de murs que Delphine Lewandowski a appelés murs « autonomes » ou « bioréceptifs ».
Elle présente ensuite les prototypes de murs biodiversitaires, dont l’originalité réside dans la continuité du substrat, une façon d’obtenir un sol vivant et un système autonome. L’autre particularité de ce type de mur est l’emploi de matériaux de construction. Le but a été de sélectionner des éléments de construction peu onéreux et issus de réemploi.
Trois types de prototypes ont ainsi été testés : pierre sèche, brique pleine et brique alvéolée. Delphine Lewandowski présente les plans de construction des différents types de murs ainsi que quelques images. Elle liste également les espèces qui y ont été plantées avec l’objectif de tester différentes variétés et à différents étages.
Les murs ont ensuite été étudiés durant un an et demi, avec des résultats variables selon les types de murs, les espèces et les orientations. Cette étude a permis de définir des conditions techniques et biologiques de base pour les murs biodiverses ainsi qu’une méthodologie de conception avec différents critères.
Delphine Lewandowski conclut en soulignant qu’un tel projet permet d’aller vers une conception plus écocentrée et moins anthropocentrée.